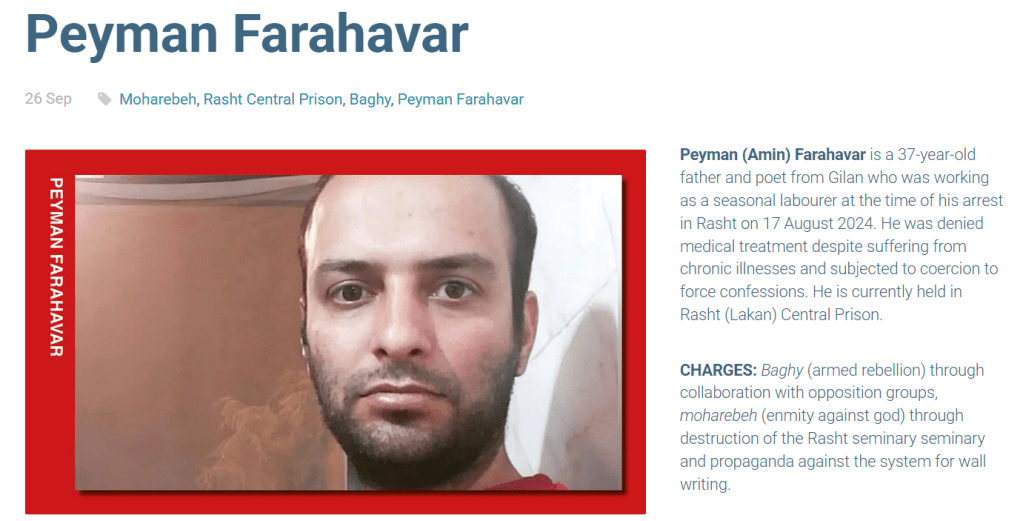Par Bernard J. Henry
«Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté».
C’est ce que chantait Guy Béart en 1968, alors que la révolte politique grondait en France et ailleurs. Au départ inspiré pour sa chanson La vérité par l’une des premières anecdotes sur le dopage dans le cyclisme, Béart a élargi sa chanson à l’assassinat de John F. Kennedy, à la répression des écrivains en URSS et même au calvaire de Jésus-Christ, rendant hommage aux victimes du refus de la liberté d’expression et, in fine, se mettant lui-même en scène en tant que victime potentielle des «murmures» et des «tomates mûres» de son public qu’il voyait déjà, à son tour, l’exécuter ! Heureusement non, pas plus qu’après Les couleurs du temps l’année passée, chanson qui est pour moi un hymne personnel.
Aujourd’hui hélas, les autorités de l’Iran, où l’assassinat de la jeune Masha Jina Amini par les Gardiens de la Révolutions (Pasdaran) en septembre 2022 a fait naître des revendications de liberté sous le slogan «Femme, Vie, Liberté» qui, même réprimées, ne se sont jamais tues, semblent avoir pris ce refrain de Guy Béart au pied de la lettre puisqu’elles entendent précisément exécuter un poète, Peyman Farahavar.
De la part de la théocratie chiite de Téhéran, rivale par excellence de celle sunnite d’Arabie saoudite qui est aussi pour elle une solide concurrente en termes de violations des Droits Humains, rien de bien surprenant, certes. Qui croit tirer son pouvoir politique de la parole divine n’admet aucune œuvre de l’esprit humain. Pourtant, Peyman Farahavar a bien d’autres raisons, en fait toutes les raisons, de déplaire au régime des mollahs.
Trop croyant pour devenir théocrate
Quand une idéologie de libération fonde un système politique qui, lui-même, évolue ou plutôt dégénère en dictature, il y a toujours des gens qui, même soutenant le système, s’accrochent aux idéaux et aux principes de la libération rêvée en croyant les pérenniser par leur adhésion à l’institution. Certains resteront fidèles au système quoi qu’il arrive, persuadés de pouvoir le changer de l’intérieur par leur seule intégrité – et bien souvent voués à rester déçus –, tandis que d’autres, poussés au bout du dégoût, le quitteront s’ils le peuvent. Dans la défunte Tchécoslovaquie, un Alexander Dubček rêvant d’un «communisme à visage humain» avait tôt fait d’irriter les tenants moscovites d’un communisme répressif, puis de voir s’abattre sur son Printemps de Prague, en plein cœur de l’été, l’hiver des chars.
Promis à un avenir de mollah réprimant lui aussi son peuple, au nom d’un chiisme vidé de sa substance pour devenir l’instrument pérenne du totalitarisme, Peyman Farahavar s’y est refusé. Aux yeux du pouvoir de Téhéran, première faute.
A trente-sept ans, Peyman Farahavar, également prénommé Amin, originaire de la province de Gilan bordée par la Mer Caspienne et voisine de l’Azerbaïdjan, n’a pas toujours été le primeur de rue et père de famille comme tant d’autres qu’il est aujourd’hui. Comme le révèle IranWire, il était au départ séminariste. Comme son gouvernement, il avait fait de la religion et du culte des martyrs de la révolution islamique les piliers de sa vie. A la ville, il portait les robes des dignitaires chiites que la République islamique érige en aristocratie. A cette différence près que Peyman Farahavar, religieux dans l’âme, ne voyait pas le chiisme comme un instrument d’oppression.
Ecœuré par la manière dont les autorités de Téhéran avaient transformé la religion et la mémoire de la révolution en un «business», il s’était défroqué et avait abandonné sa vie cléricale pour devenir vendeur de rue, primeur spécialiste des fruits, travaillant chaque jour avec son frère pour gagner sa vie et nourrir son petit garçon de dix ans.
Il fustigeait désormais sans concession ces autorités qu’il en était venu à détester, s’opposant farouchement à l’oppression du peuple qu’il reprochait à ces gens auxquels son parcours le vouait au départ à ressembler. La robe des mollahs était devenue pour lui symbole de cette oppression. Pour lui, plus question de la porter encore, et l’enlever voulait dire rejeter non pas la religion, mais le régime qui se faisait oppresseur en son nom.
Devenu voix des sans-voix, Peyman Farahavar criblait sur ses réseaux sociaux «la supériorité autoproclamée du clergé chiite en Iran», ainsi que l’exploitation par le gouvernement «du sang et de la religion des martyrs». Il s’était indigné publiquement du sort de la jeune Mardak Maryaneh, jeune fille de seize ans qui, arrêtée et détenue, s’était suicidée après sa libération.
La prison, Peyman Farahavar allait la découvrir lui-même en mai 2022, avant que l’Iran ne résonne du slogan «Femme, Vie, Liberté». Arrêté une nouvelle fois le 18 août 2024 à Racht, capitale du Gilan, Peyman Farahavar fut détenu vingt-six jours au secret avant d’être transféré à la Section de sécurité de la Prison de Lakan, toujours à Racht. Avant même sa condamnation à mort, il allait bientôt être arraché violemment au monde des vivants.
Une poésie belle et forte à mourir
Dans des prisons iraniennes dont la réputation de barbarie n’est plus à faire, encore moins à ignorer, Peyman Farahavar n’avait aucune chance d’échapper au sort le plus barbare, dont les autorités, pénitentiaires et autres, comptaient sur le fait qu’il demeure aussi le sort le plus ignoré. Par bonheur, pari perdu.
Les sources d’IranWire évoquent des tortures si extrêmes qu’un jour, Peyman Farahavar en a perdu connaissance pendant vingt-quatre heures, mais aussi des saignements gastro-intestinaux persistants, des dérèglements lymphatiques provoquant des furoncles douloureux sur tout le corps, et pas le moindre traitement médical qu’il se voit constamment refuser. Au-delà du corps, l’esprit et le cœur souffrent aussi, de l’absence d’un fils auquel il n’est jamais permis de voir son père, ce qui serait voulu, poursuit IranWire, par une ex-belle-famille vindicative adossée aux Gardiens de la Révolution.
A bien y réfléchir, pourquoi les autorités ménageraient-elles Peyman Farahavar alors que, tout au contraire, elles s’acharnent sur lui pour des aveux ? A coups de «graves tortures psychologiques et physiques», elles exigent qu’il avoue. Avouer ? Mais quoi, au juste ? Qu’il aurait, comme l’en accusent les autorités, déclenché un incendie volontaire sur un chantier ? En pareil cas, Peyman Farahavar n’aurait pas été autant interrogé sur ses écrits, littérale obsession de ses geôliers.
«Le crayon sera sa clé, les feuilles son issue», chantait la regrettée Teri Moise dans Les poèmes de Michelle, son hommage aux enfants travailleurs en un temps où l’on n’en parlait encore que peu. Les Gardiens de la Révolution islamique, redoutables miliciens théocrates de Téhéran, ont bien compris que c’est aussi le cas de Peyman Farahavar, insupportablement libre même dans sa cellule, puisqu’ils se sont employés à détruire ses carnets de notes où figuraient ses poèmes, même lisibles de ses seuls codétenus, car c’était apparemment déjà trop.
Vivant de peu, suivi par seulement quelques centaines de personnes sur Instagram, Peyman Farahavar n’en a pas moins fait suffisamment peur à l’Etat, comme le relève IranWire, pour se retrouver frappé d’une peine de mort. Ces fameux Gardiens de la Révolution, il leur avait fait un sort dans un poème que l’un de ses anciens codétenus décrit comme «très implacable et très beau», lui qui se souvient de Peyman Farahavar comme d’un poète doué pour la satire contestataire et, surtout, pour l’improvisation, à tel point qu’il suffisait d ’ «attiser» en lui la verve poétique pour qu’elle explose en bouquets de vers subversifs d’un savoureux vitriol.
Rien ni personne n’était épargné parmi ce qui révoltait l’ancien mollah en devenir. Incendiaire, oui, il l’était sur la corruption enracinée dans les institutions, les questions liées à l’environnement, mais aussi la fierté culturelle de la population du Gilan. Peyman Farahavar fustigeait les ventes, devenues monnaie courante, de terres agricoles du Gilan à des Iraniens d’autres parties du pays, ainsi que le gaspillage des ressources naturelles de la province par les sociétés immobilières. Jaloux de son identité provinciale, il proclamait son admiration pour les héros locaux, dont Mirza Kuchik Khan, homme politique et chef militaire du début du vingtième siècle. Voix des sans-voix, remarque encore IranWire, Peyman Farahavar portait celle d’un peuple oublié, celle des pauvres, celle des villageois dont la souffrance n’intéressait pas Téhéran.
Pour les mollahs, voilà bien de quoi vouloir exécuter un poète, la peine prononcée contre Peyman Farahavar ayant été confirmée y compris par la Cour suprême iranienne le 24 septembre.
Ecrivez sa liberté
«A quoi sert une chanson si elle est désarmée ?», demandait Julien Clerc en 1993 dans Utile, citant une expression chilienne, «La chanson sans armes ne sert à rien, la chanson sans balles n’affronte pas le fusil». La chanson, Maurice Druon y voyait la «forme moderne de la poésie», bien que la forme traditionnelle n’ait jamais cessé d’exister. Dix ans avant Julien Clerc, Daniel Balavoine évoquait la torture d’un poète dans Frappe avec ta tête. Neuf ans auparavant encore, Michel Delpech ouvrait la voie en unissant poésie et chanson dans Rimbaud chanterait, imaginant un Arthur Rimbaud ayant vécu à cette époque et qui, là où le dix-neuvième siècle l’a vu poète, aurait été chanteur, «lui, l’homme fou, l’ami, le déserteur».
A quoi servait à Guy Béart de chanter La vérité en 1968 ? Les étudiants français en révolte contre le système savaient tout au moins à quoi leur servait la chanson, qu’ils entonnaient parfois dans leurs meetings face à un pouvoir politique en lequel ils voyaient un ultime censeur.
Aujourd’hui, le poète qui a «dit la vérité» se nomme Peyman Farahavar, et dans une illustration insupportablement littérale des vers de Guy Béart, Téhéran entend l’exécuter, sous des motifs fantoches, pour sa seule poésie. Une poésie qui n’a pas besoin de dire à quoi elle sert, car les actes parlent, comme les mots dérangent.
Même pour qui n’est pas poète, un langage poli et un ton décidé suffisent pour dire non au massacre d’un innocent. Il y a toujours une ambassade iranienne, ou bien une mission auprès des Nations Unies à New York, Genève ou Vienne, dans le pire des cas une délégation permanente à l’UNESCO, à contacter. Il serait dommage de priver d’un tel soutien Peyman Farahavar, ainsi que de s’en priver soi-même lorsque l’on peut écrire et dire la vérité sans craindre d’être, comme Téhéran le lui promet, exécuté.
Bernard J. Henry est Officier des Relations Extérieures de l’Association of World Citizens.